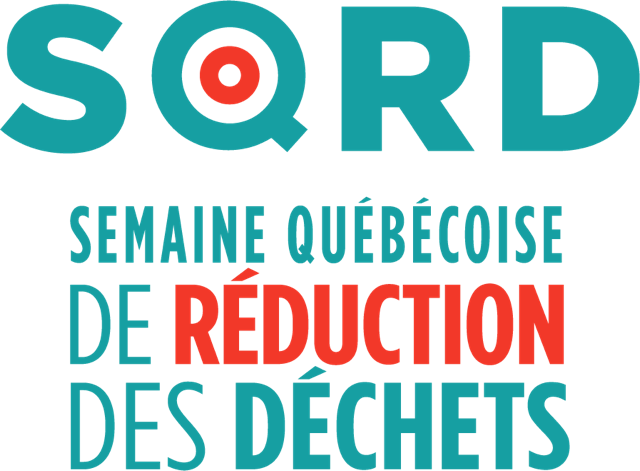« J’en ai assez des déchets, et j’en ai assez pour réduire ceux que je produis »
C’est dans cet esprit que la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) vous convie une fois de plus à vous mobiliser pour la réduction des déchets. Notre programmation de la 25ème édition saura convaincre même les personnes les moins convaincues. Nous vous invitons à participer aux événements gratuits offerts tout au long de la semaine. Ce faisant, nous donnerons le coup d’envoi d’un autre 25 ans d’initiatives novatrices en réduction à la source. Mais juste avant de se tourner vers l’avenir, permettez-nous de vous ramener en arrière…
25 ans de SQRD
Cette édition marque le 25ème anniversaire de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Depuis maintenant un quart de siècle, cet événement souligné partout au Québec joue un rôle clé dans la promotion et l’encouragement de la réduction de déchets à la source.
Chaque année, nous offrons une plateforme d’échanges sur les pratiques responsables, où des spécialistes du sujet viennent à la rencontre du grand public. Nos diverses activités permettent de s’informer et de s’outiller afin d’incorporer des gestes concrets de réduction dans le quotidien des gens.
La Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) a vu le jour en 2001. À l’époque déjà, la problématique de la surproduction de déchets et ses effets néfastes pour l’environnement retenait l’attention des groupes et des militants. Malgré les progrès réalisés, le Québec génère encore 13 millions de tonnes de matières résiduelles chaque année, soit l’équivalent d’un camion de 25 tonnes par minute. Parmi celles-ci, 5,4 millions de tonnes sont encore enfouies ou incinérées.
Durant ces 25 dernières années, la SQRD s’est adressé à un grand nombre de citoyen·ne·s, de travailleur·se·s et d’étudiant·e·s dans le but de les sensibiliser à l’impact environnemental de nos déchets. La SQRD se fait aussi un devoir d’épauler les entreprises, les organismes, les institutions et les municipalités dans la mise en œuvre de leurs initiatives de réduction à la source.



En 2022, notre projet a franchi une nouvelle étape en lançant la SQRD à l’année ! En plus de la Semaine tenue en octobre, nous offrons maintenant du contenu éducatif et des activités tout au long de l’année. Cette nouvelle formule vise à rassembler une communauté engagée ainsi qu’à renforcer l’élan collectif vers la réduction, en offrant un soutien continu et des ressources accessibles à tous.
25 ans de réduction à la source
La réduction à la source consiste à agir en amont afin de réduire l’utilisation de ressources et de matières qui entrent dans l’économie pour la production de biens, en favorisant notamment leur entretien et leur réparation. Pris simplement, c’est tout ce qui permet d’éviter de créer un déchet. Elle permet ainsi d’éviter les coûts environnementaux de l’extraction et la transformation des ressources, et également de réduire les impacts qui résultent de la consommation et de la disposition des biens. En réduisant notre consommation de ressources, nous limitons la quantité de déchets générés. La réduction à la source demeure la première composante des 3RV : réduction, réemploi, recyclage et valorisation.
En 1989, la Politique de gestion intégrée des déchets solides introduit pour la première fois au Québec la hiérarchie des 3RV, accompagné d’un objectif ambitieux : réduire de 50% les déchets destinés à l’élimination d’ici l’an 2000. Cependant, à l’époque, peu d’actions concrètes étaient mises en œuvre pour favoriser la réduction à la source.
Depuis le début des années 2000, cette approche a toutefois commencé à s’ancrer graduellement dans les pratiques québécoises. Plusieurs progrès notables ont été réalisés en matière de réduction à la source, témoignant d’une volonté croissante de repenser notre rapport aux déchets.

En 2001, la Loi sur la Qualité de l’environnement est adoptée et mentionne l’importance de la gestion des déchets selon la hiérarchie des 3RV.
En 2006, le Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination des matières résiduelles entre en vigueur, imposant un montant additionnel à payer pour chaque tonne sur chaque tonne de matières résiduelles envoyée à l’élimination, dans le but d’encourager la réduction de déchets se rendant à l’enfouissement ou à l’incinération. Cette redevance sera doublée en 2010.
En 2011, l’adoption de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) permet la révision de la Loi sur la qualité de l’environnement afin de clarifier la hiérarchie des 3RV pour que la réduction à la source soit réellement priorisée. En effet, son objectif premier est « de prévenir ou réduire la production de matières résiduelles, notamment en agissant sur la fabrication et la mise en marché des produits ».
En 2018, la Ville de Montréal bannit la distribution de sacs de plastique à usage unique. Plusieurs municipalités mettent en place des mesures similaires dans le but d’éliminer l’utilisation de sacs jetables, réduisant ainsi sa production.
Le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025 de la Ville de Montréal oriente ses objectifs vers le zéro déchet, faisant la promotion d’un « changement de culture permettant d’éliminer toutes les matières résiduelles qui sont actuellement destinées à l’enfouissement ». La réduction à la source est identifiée comme stratégie principale, avant la valorisation et la récupération. Au-delà de cet objectif central, les démarches individuelles vers le zéro déchet intégré dans le mode de vie sont également encouragées par le Plan. Celui-ci prévoit également une contribution financière pour les programmes d’arrondissement ou d’organismes communautaires appuyant l’adoption d’un mode de vie zéro déchet, soutenant des initiatives telles que des projets de compostage domestique, d’ateliers de réparation, de prêts d’objets et de sensibilisation à la consommation responsable. Un budget de 2 millions de dollars annuel est attribué à la réduction à la source.
En 2022, Le Canada impose un Règlement interdisant certains plastiques à usage unique, dont des sacs, ustensiles, contenants alimentaires, etc. Des initiatives réglementaires locales apparaissent également la même année. Par exemple, la municipalité de Prévost met en place une redevance pour la vente de certains produits à usage unique. Grâce à celle-ci, 55 000$ ont été récoltés la première année et investis dans des initiatives de réduction à la source et de réemploi. La Ville de Terrebonne a également fait sa part la même année en interdisant la distribution de vaisselle jetable.
En 2023, l’Assemblée nationale du Québec adopte à l’unanimité le projet de loi n° 29, protégeant les consommateur·trice·s contre l’obsolescence programmée. Elle interdit désormais le recours à des méthodes qui diminueraient la durabilité des produits électriques ou électroniques. De plus, elle propose un ensemble de mesures visant à rendre la réparation de ces mêmes biens plus accessible pour les consommateur·trice·s. La défiance de cette loi par une entreprise entraînerait des sanctions allant jusqu’à 125 000$ ou à 5% de son chiffre d’affaires annuel mondial.
En 2025, avec la modernisation de la collecte sélective sous un principe de responsabilité élargie des producteurs, ce sont désormais les acteurs qui mettent en marché des matières doivent les prendre en charge en fin de vie. Chaque producteur a une contribution financière qui est proportionnelle à la quantité de contenants, d’emballages et d’imprimés qu’il met en marché. Ce système incite les entreprises désireuses de réduire leurs coûts à revoir leur pratiques et à opter pour l’écoconception. De plus, au cours des dernières années, des contributions supplémentaires ont été imposées pour des types de matières plus difficilement valorisables en fin de vie. On pense, par exemple, aux plastiques biodégradables. Encore une fois, ces modulations incitent les producteurs à se tourner vers des matières plus faciles à valoriser ou à revoir leur pratique de manière à favoriser la réduction à la source.

Au fil des ans, l’engouement pour un mode de vie zéro déchet s’est considérablement amplifié. De nombreux regroupements citoyens et organismes à but non lucratif ont ainsi émergé avec la mission de sensibiliser leur communauté sur les bienfaits environnementaux et sociaux du zéro déchet. L’apparition de ces initiatives témoigne d’un engagement collectif de plus en plus fort en faveur de la réduction à la source, et grâce à celui-ci, les services de réparation, de location ou de don sont maintenant plus accessibles. D’ailleurs, le site de Québec circulaire met à disposition un outil de cartographie qui recense les projets liés à l’économie circulaire, mais également à la réduction à travers la province.
Sur le plan individuel, un changement de comportements a été noté par un sondage de RECYC-QUÉBEC de 2021. En effet, 78% des participant·e·s disent se retourner vers la réparation plutôt que le remplacement de leurs objets défectueux et 61% de ces personnes achètent ou vendent des objets d’occasion, une augmentation notable depuis 2015. Selon RECYC-QUÉBEC, « l’étude révèle que les pratiques de réduction à la source, de réemploi et de réparation font de plus en plus partie du quotidien de la population. » Les ménages québécois contribuent de façon plus instinctive à la réduction à la source en achetant davantage des biens usagés, en louant ou en empruntant du matériel ou encore en optant pour des produits réutilisables.
Ces avancées démontrent un engagement collectif croissant au sein de notre société – tant au niveau des gouvernements que des citoyens – pour réduire notre production de déchets. En 25 ans, de bonnes bases ont été établies afin de soutenir une transition vers une société plus durable.
Et pour les 25 prochaines années ?
Malgré les avancées constantes en matière de gestion des déchets, le Québec figure toujours parmi les régions où l’on élimine le plus de matières résiduelles par habitant à l’échelle mondiale. En 2023, cette quantité atteignait en moyenne 685 kg par personne, soit plus de 100 kg au-dessus de la cible fixée par le gouvernement pour cette année-là. Ces chiffres mettent en lumière les limites actuelles des efforts de réduction à la source, qui peinent à suivre le rythme toujours croissant de notre consommation des ressources.
L’interdiction de certains plastiques à usage unique, bien que louable, entraîne bien souvent une simple substitution par d’autres matériaux (comme le carton, le bois ou le bioplastique), sans réelle réduction de la quantité de déchets générés. Ainsi, le problème est déplacé plutôt que résolu, d’autant plus que le tri de ces différentes matières ne se fait pas toujours de façon adéquate. Par ailleurs, plusieurs initiatives gouvernementales continuent de privilégier le recyclage et la valorisation des déchets, au détriment de la réduction à la source, qui devrait pourtant être la priorité selon la hiérarchie des 3RV.
Ce phénomène dépasse largement les frontières québécoises. À l’échelle mondiale, la situation est tout aussi préoccupante. Selon les Nations Unies, si aucune mesure radicale n’est prise, la production de déchets courants atteindra 3,8 milliards de tonnes d’ici 2050. Cela souligne l’urgence d’agir pour instaurer une culture axée sur la sobriété matérielle et la réduction à la source, afin de bâtir une société véritablement engagée dans la transition écologique.

J’en ai assez !
C’est pourquoi nous voulons réaffirmer notre position et notre engagement envers la réduction à la source avec la phrase « J’en ai assez ! ». À la fois revendicateur et porteur d’espoir, ce thème a pour objectif de nous permettre collectivement d’exprimer non seulement nos revendications, mais également d’y apporter des solutions. Autrement dit, nous voulons passer de « J’en ai assez de la surconsommation » à « J’en ai assez pour réduire ma consommation ». Dans le cadre de cette thématique principale, nous vous proposerons cette semaine des articles qui traitent de différents enjeux affiliés à la réduction de déchets.
Durant les prochains jours, crions haut et fort : « J’en ai assez ! ». Réaffirmons notre position quant à l’importance de la réduction à la source, et prouvons-nous que nous avons accès collectivement à tout ce qu’il nous faut pour être heureux·se·s.
Du 20 au 26 octobre 2025, conférence, atelier, webinaire et projection de film vous attendent. Vous pourrez en apprendre davantage et échanger sur les meilleures façons de consommer de manière responsable, pour l’environnement et votre bien-être. Ensemble, réitérons que nous en avons assez pour réduire nos déchets, et continuons à faire une différence dans notre communauté !
Bon 25ème anniversaire de la Semaine québécoise de réduction des déchets !