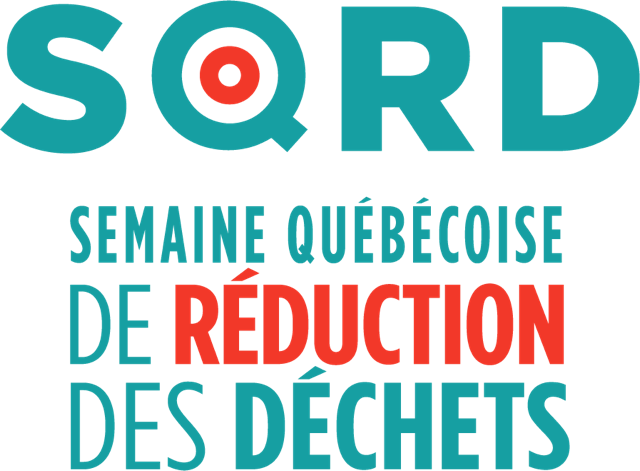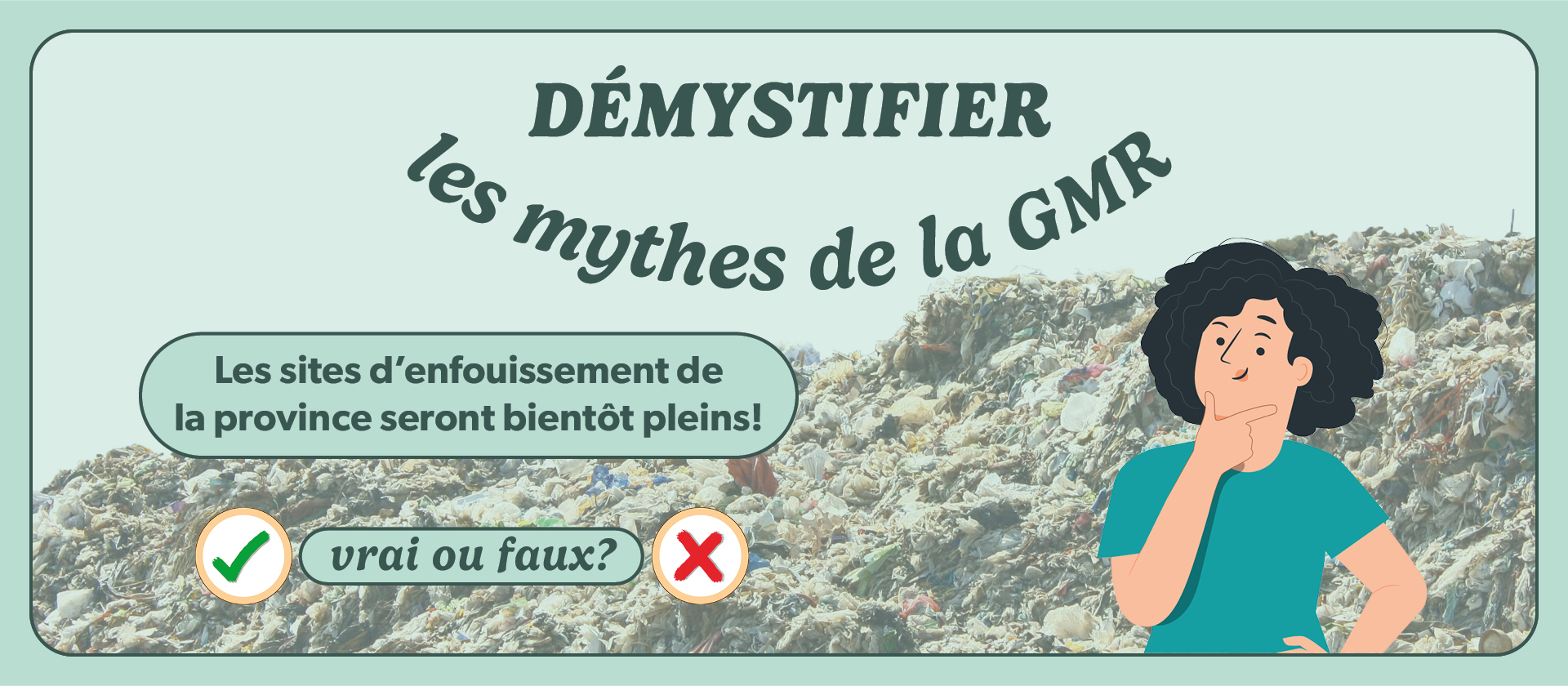On voit parfois dans les nouvelles que certains des plus grands sites d’enfouissement de la province seront bientôt pleins. C’est vrai et c’est faux à la fois, mais, pour mieux s’y retrouver, il faut s’intéresser brièvement à la manière dont fonctionne l’agrandissement des sites d’enfouissement au Québec.
Les lieux d’enfouissement technique sont la principale façon d’éliminer des déchets au Québec. Dans son application la plus simple, il s’agit d’un terrain sur lequel on creuse un trou dans lequel on déverse les déchets. Le tout est fait en respectant l’ensemble des normes environnementales mises en place par le gouvernement. C’est d’ailleurs ce dernier point qui distingue un lieu d’enfouissement technique d’un dépotoir ou d’un dépôt sauvage.
Lorsque le gouvernement autorise la mise en place d’un site d’enfouissement, on connaît déjà la quantité totale de déchets que le site est autorisé à recevoir ainsi que la quantité de matières que le site reçoit chaque année. On peut donc, au moment de l’autorisation, connaître la durée de vie du site en effectuant une simple règle de trois. Pris autrement, lorsqu’on annonce qu’un site d’enfouissement est “presque plein”, il faut d’abord se rappeler qu’il ne s’agit pas vraiment d’une nouvelle; l’information est connue depuis des années. Pourquoi alors les déclarations du genre sont-elles reprises par les médias?

Pour bien comprendre ce phénomène, il faut savoir que la plupart des grands sites d’enfouissement de la province sont gérés de manière privée et qu’ils génèrent un important profit. Pour les entreprises qui œuvrent dans le domaine, assurer une nouvelle phase d’expansion de leur site, c’est aussi assurer la survie de leur entreprise. De plus, même lorsque les sites sont de propriété publique, ils peuvent représenter une importante source de revenus pour les municipalités qui les détiennent.
Dans ce contexte, les gestionnaires de site ont tout intérêt à mettre de l’avant les conséquences potentielles d’une éventuelle fermeture de leur site après la phase d’exploitation en cours. Toutefois, dans les faits, ces mêmes gestionnaires ont, dans la quasi-totalité des cas, déjà identifié de nouveaux terrains qui pourraient servir à une nouvelle phase d’expansion du site. Ils peuvent ainsi brandir aussi bien le problème que sa solution.
On note également que la pression effectuée par les promoteurs de sites d’enfouissement bénéficie de l’absence de planification provinciale au niveau de l’élimination. À l’heure actuelle, il n’y a pas de réelle stratégie cohérente visant à anticiper les besoins d’élimination du Québec et leur répartition sur le territoire. Les projets d’agrandissement des sites d’enfouissement sont donc jugés et planifiés « à la pièce », ce qui tend à favoriser des pratiques de surenfouissement. Une planification à long terme des besoins qui miserait sur la gestion régionale des matières résiduelles serait pertinente afin de pallier ce manque.

Pour conclure : il est vrai que certains grands sites pourraient arriver au maximum de leur capacité si le gouvernement n’autorise pas de nouvelle phase d’expansion. Toutefois, cet état de fait n’a rien de surprenant et l’utilisation de ce constat relève souvent plus d’une campagne de relations publiques que d’une réelle préoccupation quant à la capacité d’enfouissement au Québec. Lorsque ces informations sont relayées dans les médias, il y a lieu d’identifier leur source et de se pencher sur les intérêts de cette dernière.