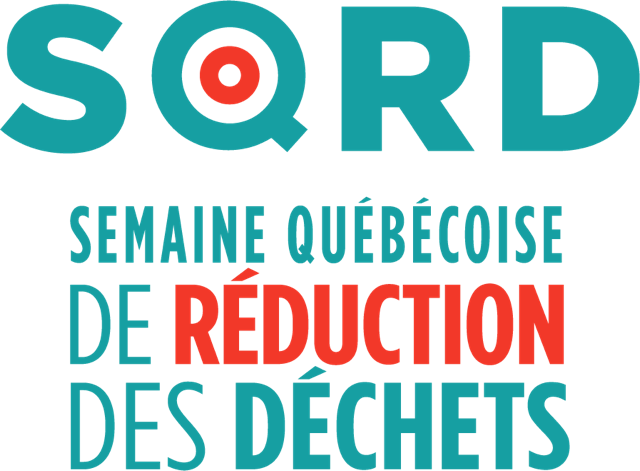La recherche du bonheur est une valeur quasi-universelle. En fait, il est difficile d’imaginer une personne qui n’aurait pas pour ambition d’atteindre un état de bien-être durable ou d’améliorer son sort. En dépit de l’omniprésence du concept, il est toutefois plus difficile d’avancer quels éléments précis mènent au bonheur. En cause, d’innombrables courants de pensées, de grandes religions, et de philosophies personnelles mettent de l’avant différentes manières de s’épanouir. Il est tout de même possible d’identifier certains lieux communs. Par exemple, la culture dans laquelle nous baignons a une influence sur la façon dont chaque personne entrevoit son bonheur. À cet effet, les sociétés nord-américaines sont marquées par une forte prévalence de l’idée selon laquelle la quête d’argent et de possessions est un élément essentiel permettant d’être heureux.
Concrètement, on peut entrevoir des exemples de l’association du bonheur avec la consommation dans les tendances de marketing; en 2016, Coca-Cola modifiait sa stratégie publicitaire jusqu’alors axée sur le slogan « ouvrez le bonheur » (open happiness). La raison? Selon le directeur du marketing de l’entreprise, le bonheur serait devenu une promesse surutilisée dans le domaine publicitaire. Cela empêcherait notamment Coca-Cola d’en faire un outil de distinction avec d’autres marques. Bien qu’elle ne soit qu’un exemple, cette histoire illustre bien la manière dont le lien entre le bonheur et la consommation est répandu.
Portées par des objections environnementales, financières ou morales, certaines voix se sont élevées pour remettre en question les bienfaits de l’accumulation matérielle. Ces contestations se sont cristallisées, selon les lieux et les époques, autour de courants comme la simplicité volontaire, le minimalisme ou le « slow living ». Ces écoles de pensée, tout en présentant certaines différences, partagent aussi des constats essentiels quant aux normes sociales dominantes. Émanant d’une désillusion face à l’épanouissement qui peut résulter d’une quête de richesse, de productivité, ou de consommation, elles présentent toutes des manières alternatives de mener une vie plus heureuse.
Devant cette opposition, on peut se demander qui a raison et, surtout, ce qui nous apporte véritablement du bonheur. Au-delà des partis-pris, quels sont les éléments dont l’efficacité a été démontrée pour parvenir à une vie heureuse?

Quel bonheur à trouver dans l’argent et dans les choses ?
Il est difficile de parler de bonheur et de consommation sans évoquer la question du revenu. L’argent et les possessions matérielles sont bien associés dans notre imaginaire collectif et il est pertinent d’aborder ce lien lorsqu’on s’intéresse à chacun de ces éléments. Il est toutefois intéressant de constater que la richesse et la consommation ont toutes deux des relations distinctes avec le bonheur.
En commençant avec l’argent, la question la plus naturelle est certainement de se demander si on peut faire confiance à la formule voulant que « l’argent fasse le bonheur ». Une étude célèbre publiée en 2010 par deux récipients de prix Nobel évoquait l’idée qu’une augmentation de revenu avait un impact positif sur le bonheur, mais que cet effet diminuait rapidement à partir d’environ 75 000$ par année (soit environ 102 000$ en 2025 en appliquant un taux d’inflation canadien). Selon les auteurs, au-delà de ce seuil, l’argent accumulé ne contribuerait pas à allouer des ressources supplémentaires au bien-être émotionnel, que ce soit en passant du temps avec des proches, en ayant des loisirs ou en prenant soin de sa santé.
Les résultats de cette étude ont eu un impact majeur sur le discours entourant la rémunération. Dans leur sillage, on a même pu recenser des cas anecdotiques d’entreprises ayant augmenté les salaires de leurs employés afin de se conformer davantage à un plancher de 75 000$. Encore aujourd’hui, les résultats de l’étude ont marqué l’imaginaire collectif en appuyant l’idée qu’au-delà d’un certain seuil, il ne sert à rien de chercher à s’enrichir si l’on souhaite surtout être heureux.
Plus récemment, en 2023, certains des chercheurs ayant contribué à établir le plafonnement du bonheur à 75 000$ ont publié un nouvel article révisant leurs résultats initiaux. Cette mise à jour recontextualise fondamentalement les résultats de l’étude précédente. En révisant la manière dont ils mesuraient le bonheur des participants, les chercheurs sont plutôt arrivés à la conclusion que, dans la majorité des cas, le fait d’avoir accès à plus d’argent rendait les gens plus heureux. Le plafond précédemment décelé à 75 000$ ne venait toutefois pas de nulle part; il représentait plutôt une frontière approximative en dessous de laquelle le manque d’argent pouvait nuire au bonheur des gens. Bref, selon les données les plus récentes, il semblerait que, pour la plupart des gens, l’argent contribue au bonheur et qu’un manque d’argent puisse, à l’inverse, rendre malheureux.
Mais une distinction importante s’impose. Si l’argent donne accès à un niveau de consommation plus élevé, cela ne veut pas pour autant dire que les vertus d’un meilleur salaire sont nécessairement transposables à l’accumulation matérielle. En fait, la recherche semble indiquer que c’est plutôt le contraire.
Des psychologues ont tenté de dresser un portrait des connaissances actuelles sur le lien entre le matérialisme et le bonheur. En analysant 175 études réalisées au préalable, les auteurs ont relevé une relation strictement négative entre l’adhésion au matérialisme et le bien-être individuel. Cette relation pouvait être plus ou moins importante d’un groupe de la population à un autre. Elle était toutefois maintenue pour toutes les populations analysées. Pris autrement, le matérialisme peut rendre plus ou moins malheureux selon notre situation, mais, à grande échelle, il ne contribuera jamais à l’atteinte du bonheur.
Il faut bien comprendre que ce résultat n’est pas en contradiction avec l’idée que le revenu peut augmenter le bonheur; le matérialisme étudié par les chercheurs ne mesure pas directement le revenu, mais plutôt un endossement de valeurs et d’objectifs de vie centrés sur l’importance d’acquérir plus d’argent et de possessions, notamment pour améliorer son statut social.
Bref, l’argent peut faire partie des éléments constitutifs d’une vie heureuse; son absence peut nous nuire et sa présence peut nous donner la liberté de nous investir dans les choses qui nous apportent de la joie. Il ne semble toutefois pas être une fin en soi. En effet, le fait d’avoir des objectifs de vie qui nous poussent à chercher la richesse, l’accumulation de biens ou un statut social plus élevé ne nous rendent pas heureux. En fait, ces valeurs sont surtout susceptibles de nuire à notre épanouissement.

La simplicité volontaire est-elle la solution ?
Si le fait d’accorder beaucoup d’importance à l’argent et aux possessions nous rend moins heureux, notre réaction devrait-elle être d’adopter une vision de la vie qui va directement à l’opposé du matérialisme? Le minimalisme est une des réponses au matérialisme et au consumérisme qui a suscité le plus d’engouement au cours des dernières années. On peut voir le minimalisme comme une démarche personnelle visant à épurer sa vie des éléments qui n’apportent pas de bonheur pour accorder plus d’attention à ceux qui contribuent au bien-être. Concrètement, cette approche se transpose en une remise en question de la quête d’accumulation matérielle en favorisant une approche délibérée d’acquisition d’objets. Elle vise aussi plus largement à encourager une allocation de son temps aux éléments de la vie qui contribuent au bonheur. Si, par exemple, une personne a un emploi du temps chargé au point d’être stressant, une démarche minimaliste pourrait l’amener à l’alléger en priorisant uniquement les éléments qui sont les plus importants pour elle.
Bien que le minimalisme soit une des alternatives les plus populaires au matérialisme à l’heure actuelle, les études sur les impacts de cette démarche sur les personnes qui l’adoptent sont plus rares. Néanmoins, les courants de pensée allant à l’encontre d’un mode de vie basé sur l’accumulation de richesse et sur la consommation ne sont pas nouveaux. Depuis les années 1960, certaines personnes se revendiquent de la simplicité volontaire. Cette philosophie peut être définie comme mode de vie axé sur une consommation frugale et sur le désir d’évoluer en communauté vers une existence plus respectueuse de l’environnement.
Le minimalisme a pour principale différence avec la simplicité volontaire qu’il s’intéresse d’abord et avant tout à l’échelle individuelle. La simplicité volontaire, pour sa part, met l’accent sur l’appartenance à une communauté et entrevoit la démarche personnelle comme une réponse à une problématique sociétale plus large. On notera également que la simplicité volontaire est intrinsèquement écologiste alors que le minimalisme n’aborde pas nécessairement de front la question environnementale. Finalement, comme le mouvement est plus vieux en occident que le minimalisme, plus de recherche a été effectuée sur la relation entre la simplicité volontaire et le bonheur.
En dépit des différences entre ces deux philosophies, elles convergent suffisamment pour considérer de manière conjointe leur effet sur le bien-être de leurs adhérents. C’est que chacune d’entre elles remet fortement en question la prépondérance de l’accumulation matérielle dans nos vies et dans notre quête de bonheur. Qu’en est-il donc du succès de ces philosophies qui se proposent justement de nous rendre plus heureux?
Une revue systématique de la littérature portant sur le lien entre la simplicité volontaire et le bien-être a permis de compiler les résultats de plus d’une vingtaine d’études sur le sujet. Dans la quasi-totalité des articles analysés, on observait une relation positive entre l’adhésion à la simplicité volontaire et le bonheur. Selon les chercheurs, ce résultat s’expliquerait, au moins en partie, par le fait que la simplicité volontaire pourrait favoriser une moins grande adhésion aux valeurs matérialistes, ce qui éviterait la réduction de bonheur qui y est associée. Mais surtout, ils expliquent que la simplicité volontaire permettrait de combler des besoins d’appartenance, de compétence et d’autonomie. Une autre revue de littérature sur le minimalisme tire des conclusions similaires; le minimalisme est positivement associé au bien-être et cette corrélation serait probablement due à des facteurs similaires à ceux évoqués dans le cas de la simplicité volontaire.
Il est intéressant de noter que les études recensées permettent d’établir une corrélation entre le minimalisme ou la simplicité volontaire et le bonheur, mais pas nécessairement un lien de causalité. En d’autres mots, il est possible d’avancer que les gens qui adhèrent à ces courants de pensée sont généralement plus heureux que des personnes ayant des valeurs matérialistes, mais cette situation pourrait être expliquée de plusieurs manières. Par exemple, il est possible que l’adhésion à la simplicité volontaire ou au minimalisme nous rende plus heureux, mais il est également envisageable que les personnes heureuses aient davantage tendance à souscrire à l’une ou l’autre de ces philosophies.
En tout et pour tout, le minimalisme ou la simplicité volontaire pourraient aller de concert avec le bonheur, mais ce sont peut-être davantage les valeurs sous-jacentes à ces courants de pensée qui favorisent le bien-être. En terminant, il est donc intéressant de se pencher sur les éléments qui semblent constituer une vie heureuse, indépendamment de leur association avec le matérialisme, la simplicité volontaire ou le minimalisme.

De quoi le bonheur est-il fait ?
Une des études les plus impressionnantes se penchant sur le bonheur est la Havard Study of Adult Development (Étude de Harvard sur le développement adulte). Ce projet de recherche, se déroulant depuis plus de 80 ans, a suivi et suit toujours le parcours de centaines d’individus tout au long de leur vie. En recueillant des entrevues, des dossiers médicaux et des récits de vie, les chercheurs ont tenté de déterminer quels éléments distinguaient les personnes rapportant de hauts niveaux de bonheur à un âge avancé. Leur conclusion est simple : ce sont d’abord et avant tout les relations significatives que nous développons et que nous entretenons qui nous assurent d’être heureux et de le demeurer.
Plus encore, l’étude a permis de révéler que la qualité des relations que nous entretenons a un impact sur notre bien-être, mais aussi sur notre santé et sur notre longévité. Des relations fortes avaient un effet protecteur en réduisant le déclin physique et cognitif. Elles avaient également un impact plus élevé que des variables comme la classe sociale ou le bagage génétique d’une personne. La relation inverse était également observable; les personnes éprouvant un sentiment de solitude en subissent les conséquences sur leur bonheur et sur leur santé. Sur ce dernier point, les responsables de l’étude notent que la solitude serait aussi nocive que le tabagisme ou l’alcoolisme.
Il mettent également en lumière l’importance de s’entourer de relation en misant sur la qualité plus que sur la quantité. Effectivement, il semble nécessaire de favoriser des relations sur lesquelles on peut compter pour faire face aux épreuves de la vie. D’ailleurs, la qualité des relations n’est pas nécessairement synonyme d’interactions paisibles. Les chercheurs donnent l’exemple de couples mariés de personnes âgées. Certains couples profondément unis pouvaient se chamailler fréquemment, mais les plus heureux restaient soudés pour faire face à des difficultés personnelles.
D’autres études font écho aux conclusions des chercheurs d’Harvard. À l’échelle individuelle, des relations sociales de qualité sont un des principaux déterminants du bonheur. D’autres éléments sont également soulevés. On pensera, entre autres, à la santé mentale et physique, à un bon équilibre de vie et à un sentiment d’harmonie avec des valeurs comme sa culture, sa tradition, sa religion, sa communauté ou son environnement. Il est clair de ces résultats que la recette du bonheur est complexe et variable. Néanmoins, les pistes qui sont avancées par la recherche peuvent offrir une base intéressante pour orienter notre propre quête de bien-être.
Conclusion
Finalement, ce que notre examen du matérialisme et du minimalisme montre, c’est qu’il n’est pas productif de baser notre recherche du bonheur en s’appuyant uniquement sur les possessions matérielles. Un certain niveau de revenu et de consommation est nécessaire à notre survie et à notre épanouissement. Néanmoins, au-delà d’un point, l’augmentation de notre revenu ne contribue à notre bien-être que dans la mesure où il nous donne une plus grande liberté. Si cette liberté est sacrifiée dans la quête de possessions matérielles et de statut social, elle est surtout susceptible de nous rendre malheureux.
Rejeter complètement les valeurs matérialistes en adhérant plutôt au minimalisme ou à la simplicité volontaire peut être une avenue salutaire. Ces deux courants semblent favoriser des orientations et des objectifs de vie qui sont compatibles avec l’atteinte du bonheur. Ils ne sont toutefois pas la seule façon de mener une vie heureuse et leur efficacité pourra varier d’une personne à l’autre.
En fait, la littérature scientifique sur le bonheur semble montrer qu’il est surtout important d’avoir ses priorités en ordre. La question est moins de savoir s’il faut consommer ou pas, mais plutôt de se demander s’il y a des choses plus importantes auxquelles on devrait se consacrer. Avant de tenter de combler un vide en achetant un bien, ne pourrait-on pas travailler à développer des connexions significatives avec les gens qui nous entourent, à maintenir de saines habitudes de vie ou à s’impliquer dans sa communauté?